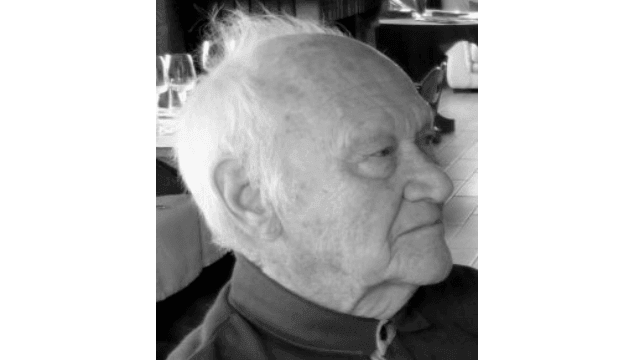Témoignage de René Lemarquis
Promotion 1945, Lettres, Saint-Cloud
La première partie de ce témoignage a été publiée dans le Bulletin n°2 de 2020 et en ligne : https://alumni.ens-lyon.fr/page/comment-je-suis-devenu-cloutier. Voici la suite et fin.
|
J’entre donc à l’ENS de Saint-Cloud en octobre ou novembre 1945. Je pense qu’aujourd’hui, en décembre 2020, il faut rappeler qu’à cette date Pierre Laval, jugé, vient d’être fusillé, que Leclerc débarque à Saigon pour s’opposer à la République du Viêt Nam que vient de proclamer Hô Chi Minh, que commence le procès de Nuremberg, que débutent l’ONU et l’UNESCO, que la Banque de France et les grands banques de crédit sont nationalisées, sans oublier la Sécurité sociale, un référendum (avec vote des femmes) sur une constituante et, pour finir, le rétablissement de la carte de pain. Tout cela sur un trimestre. De quoi parler d’autre chose que d’une carrière personnelle. L’atmosphère générale ne peut être totalement étrangère à des jeunes qui ont vécu la fin d’une guerre mondiale avec des destructions immenses, des massacres de peuples (Shoah, Hiroshima, camps de déportation, etc.). Une nouvelle organisation internationale, des pays divisés, occupés, en reconstruction ou en renaissance, en début de décolonisation.
Quelques exemples de cette présence de la guerre à l’ENS de Saint-Cloud : au début de l’année scolaire, la coutume était de présenter la nouvelle promotion dans une séance où chacun jouait un petit rôle censé le décrire. A ce sujet, j’aurais aimé que soit mieux connu notre camarade Jean Rachmann (45 L SC). Il n’est resté qu’un an à l’École avant de partir en Palestine ; son souvenir s’est vite effacé mais je me souviens de nos conversations sur le syndicalisme dans le métro ; il était intervenu dans le « front commun » que j’évoque plus loin. En 1942, ses parents avaient été raflés par la police parisienne et déportés à Auschwitz. Ma future épouse avait son amie à Vincennes et les parents de cette dernière ont été également victimes de cette même barbarie dans cette ville, le même jour[1]. D’autre part, à la session complémentaire de décembre, se trouvait Michel Ribon (45 L SC) qui avait connu le terrible camp de déportation du Struthof en Alsace. D’autres Cloutiers se sont sans doute impliqués dans cette guerre puisque je relève dans l’Annuaire de l’association (2006) les noms d’élèves morts victimes de la guerre en 1939-1945 et j’en compte dix-huit tombés en 1943-1945. Sans doute pourrait-on y compter des combattants de la Résistance ? Par ailleurs je n’ai pu résister à l’envie de citer la carrière d’un ancien élève dans l’autre camp : Georges Albertini[2] (31 L SC). Je termine ce rappel en signalant que j’ai accompagné le directeur de l’École, René Vettier (1906 L SC), à une cérémonie d’hommage dans la cour de la Sorbonne, sans doute le 11 novembre, à la mémoire des étudiants et universitaires victimes de la guerre. Le poète Paul Éluard y intervint.
La vie à l’ENS de Saint-Cloud
Revenons à la vie quotidienne dont je tente de me souvenir. Je m’aperçois que deux Bulletins de l’AE ENS comprennent des témoignages de mes camarades (André Paris, Jean Madre et Henri Denise[3]), qui sont très riches sur le cadre de l’École, les logements des rues Gaston Latouche et Pozzo di Borgo, les bâtiments, les bureaux, les salles de cours, le parc. Je ne vais pas recommencer et je me contente de relater des épisodes qui m’ont frappé (en tant que provincial déboussolé).
Je me souviens en particulier des voyages dans Paris. J’étais émerveillé par le métro que je prenais Porte de Saint-Cloud : sièges en bois, fermeture automatique des portes, deux agents en tête. L’un dans la cabine de conduite démarrait quand l’autre, dans le premier wagon, en donnait l’ordre. Auparavant, j’avais pris le bus 72 avec sa partie découverte à l’arrière où l’agent contrôleur venait avec un instrument à manivelle sur le ventre. J’utilisais également pour rentrer le soir le train de banlieue qui partait de la gare Saint-Lazare. Il fallait faire attention de ne pas louper le dernier comme cela se produisit le jour où je dus passer toute la nuit dans le quartier, ni d’omettre de descendre à la station de Saint-Cloud et d’être contraint de retourner, comme piéton, en suivant la voie électrifiée jusqu’à ladite station. De notre « dortoir » à l’École, on pouvait passer, l’autoroute A3 n’étant pas encore ouverte. Nous avons pu assister à l’ouverture de l’autoroute avec, entre autres, le bruit et les premiers accidents.
A l’École, je me souviens des repas, animés, qui me semblaient fort bons. Les plats faisaient parfois l’objet de critiques (injustifiées) du Rhino (surnom donné à l’économe car le Rhino, c’est rosse). Il faut préciser qu’à l’époque, les restrictions du temps de guerre continuaient. A propos de surnom, le ministre du ravitaillement était appelé Ramadiète. La carte de pain, rétablie en octobre 1945, ne fut supprimée qu’en décembre 1948.
La presse quotidienne dénonçait le marché noir et certains scandales. Les élèves pouvaient lire cette presse mise à leur disposition dans une salle spéciale. Les journaux étaient L’Humanité (PC), Le Populaire (PS), Franc-Tireur, Combat, Le Monde (depuis décembre 1944). Il y avait également un hebdomadaire, Action, et des publications culturelles. A ce sujet, je me souviens d’un épisode particulier peu après mon arrivée à Saint-Cloud. Un soir, des camarades philosophes m’annoncent, excités, qu’ils projetaient d’assister à l’intervention d’un certain Jean-Paul Sartre (ENS L 1924) dont je ne connaissais qu’à peine le nom. Parmi eux, il y avait Michel Oriol (45 L SC), né à Reims en 1925, son père était commis d’architecte et sa mère peintre-verrier. Il faisait partie d’un groupe de Cloutiers venus du Nord qui avaient été préparés par un certain Jean Lecanuet (oui, le futur ministre). Michel Oriol était attiré en politique par le marxisme oppositionnel (mais réticent quant au matérialisme dialectique). Nous étions coturnes à Valois et très proches d’idées, j’ai beaucoup sympathisé avec lui dès le début. Comme je n’étais pas intéressé par cette conférence de Sartre - à tort sans doute -, ils insistèrent et je les accompagnais au Quartier latin où avait lieu l’exposé devenu fameux, « L’existentialisme est un humanisme ». C’est à ce moment que parut le numéro 1 (1er octobre 1945) des Temps modernes ; j’y fus fidèle jusqu’au dernier numéro, le numéro 700.
Je ne citerai que peu de noms de camarades, volontairement. J’ai suivi le début de la carrière de Michel Oriol. Agrégé, il fut nommé à l’École normale d’instituteurs d’Alger. Nous sommes restés en relation quand il fut ensuite nommé professeur de lycée à Nice. Actif au SNES, membre du PSU, anticolonialiste, il fut inquiété pour son action à la fin de la guerre d’Algérie et engagé dans les journées de 1968. Il prépara à l’université de Nice une thèse de doctorat de sociologie sous la direction de Georges Balandier soutenue en 1989 à Paris-V à partir d’une étude d’enfants d’immigrés portugais (Identités culturelles et identités nationales : théorie et étude de cas). Paul Cazayus (46 L SC) publia en 1950 un roman écrit à l’ENS de Saint-Cloud pendant les grèves de 1947, La procession (Julliard). Je citerai aussi Jean Haritschelhar[4] (45 L SC) qui devint un ardent autonomiste basque et Georges Laplace (45 L SC), actif dans les Auberges de jeunesse (tendance « ajisme ouvrier »). Il avait fait venir un conférencier des AJ à l’École.
Un Cloutier de l’autre camp : Georges Albertini
Dans la promotion Lettres de 1931, je trouve le nom de Georges Albertini ainsi que celui de Maurice Nadeau alors militant communiste qui le cite comme opposant virulent dans les discussions. Militant des Jeunesses puis des Étudiants socialistes, Georges Albertini se prononce pour la tendance dite néo-socialiste de Marcel Déat. Dans la CGT (Fédération de l’enseignement), il était membre de la tendance du secrétaire confédéral René Belin. A sa sortie de l’ENS de Saint-Cloud il est nommé professeur d’histoire à Troyes. Membre du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA), « Munichois », il est pour favoriser les rapports économiques avec l’Allemagne en 1937. Il s’opposa au socialiste Pierre Brossolette.
En septembre 1939, G. Albertini se prononça contre la déclaration de guerre au Reich et, après la défaite de 1940, il devint l’un des dirigeants du RNP[5] et proclama son accord avec les idées du parti nazi dont les membres sont « nos frères en socialisme ». D’un anticommunisme et d’un antisémitisme violents (il y écrit en 1942 « Le communisme entreprise juive »), il dénonce la Résistance, recrute pour la Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF). Il devient secrétaire général du RNP puis directeur du cabinet de Déat qui est alors, en 1944, ministre du travail de Pierre Laval. Albertini est bien entendu arrêté à la Libération et passe en procès fin 1945. Il plaide qu’il n’avait commis qu’une « erreur de jugement » en croyant, comme Pétain, que « l’Allemagne serait victorieuse ». Reconnu coupable d’intelligence avec l’ennemi, il ne fut condamné qu’à cinq ans d’emprisonnement. Albertini a sauvé sa tête. Dans sa cellule, il devint l’ami du banquier Worms et fut libéré après trois ans de détention par grâce présidentielle en février 1948. Nous sommes alors entrés dans la guerre froide. Vincent Auriol, qui était son ami avant 1939, devenu en 1947 président d’une République engagée dans la guerre d’Indochine, est aidé par Albertini dans la rédaction d’un texte où il justifie son refus de gracier le communiste Henri Martin emprisonné pour son action contre cette guerre.
Entré à la direction de la banque Worms, Albertini participe à des publications anticommunistes comme le Bulletin d’information Est-Ouest. Il réunit des journalistes dont par exemple Claude Harmel et il est financé par le Groupement des industries métallurgiques et des services américains. Enfin, il devient le conseiller de personnalités politiques ou administratives : les renseignements généraux, le Quai d’Orsay, l’administration préfectorale. Citons Jean Baylot, Henri Frenay, Alain Madelin. Il est même écouté par Georges Pompidou, Jacques Chirac et reçu par François Mitterrand avant 1981. Il dénonce le journal Le Monde comme « agent du Kremlin ». Quelle carrière pour un Cloutier ! Disons que dans les années d’après-guerre, on n’avait pas l’occasion d’en parler à l’École.
La France à la fin de 1945
Quand j’arrive à l’ENS de Saint-Cloud fin 1945, je n’ai que peu de connaissance de la vie politique française, encore qu’au maquis vosgien j’avais été témoin d’une rupture à l’intérieur de la Résistance sans y comprendre grand-chose. Certes, j’avais été en 1938-1940 au courant des problèmes de politique extérieure ainsi que je les ai indiqués dans mon récit de cette période. Comme notre occupation s’était prolongée jusque fin novembre 1944, les problèmes de logement et de ravitaillement l’emportaient sur les péripéties politiques internes. L’image dominante en cette fin de 1945 était celle d’une résistance unie, acclamant le général de Gaulle qui avait empêché l’AMGOT[6] et qui s’efforça de réaliser l’unanimité nationale grâce à l’accord des forces politiques dans le CNR. C’est plus tard que j’appris que des conflits avaient existé dès la Libération. Par exemple entre les comités de libération s’opposant parfois aux commissaires de la République, des milices patriotiques armées qui voyaient arriver des « forces de l’ordre officielles », etc. Mais l’ampleur des réformes du programme du CNR, les impératifs de l’effort militaire, la nécessité de faire reconnaître le GRPF (en janvier 1945, la France n’est pas invitée à Yalta) expliquent sans doute cette atmosphère d’unanimité nationale. En novembre 1944, le dirigeant communiste Maurice Thorez revient de Moscou et se prononce pour le général de Gaulle qui vient de signer le pacte franco-soviétique : « Le mot d’ordre aux mineurs qui était hier de saboter est aujourd’hui de produire » (à Waziers).
La Libération n’a pas engendré un processus révolutionnaire en France. Mais la capitulation allemande coïncide avec le soulèvement algérien et une proclamation de l’indépendance en Indochine. Et se pose le problème du système économique du pays. Non pas sous la forme « capitalisme ou socialisme », les nationalisations ne s’opposent pas à l’investissement privé. On parle de « rigorisme ou libéralisme ». C’est le moment où le keynésien Pierre Mendès France s’oppose à René Pleven qui a l’appui du général de Gaulle, du socialiste Robert Lacoste et du PCF. Mendès démissionne le 5 avril pensant que l’inflation va abandonner l’économie aux forces du passé. Voilà la France de fin 1945. L’année 1946, avec la démission le 20 janvier de De Gaulle, voit la naissance du tripartisme (accord des trois partis MRP, SFIO et PCF).
Comment les Cloutiers ont-ils vécu ce début d’après-guerre ?
Bien entendu on peut, à juste titre, penser que leur préoccupation porte sur leurs études (malgré ce que j’affirme dans le début de ce texte) et j’y reviendrai. En attendant, voici quelques souvenirs.
Peu de temps après la rentrée, lors d’un repas du soir, un élève se lève et prend la parole pour inviter à une réunion ceux qui sont pour un pouvoir de la gauche. Il dit même « pour un front unique des partis ouvriers ». Comme je suis officiellement un étudiant socialiste, j’y assiste évidemment (je ne sais pourquoi, je propose « front commun plutôt que front unique »). La séance se passe dans la turne d’un (ou deux ?) camarade du PC. On décide de réaliser une série de réunions et de rendre publique cette initiative. Je me charge d’un exposé sur la position des organisations ouvrières dans la guerre de 14-18. J’ai lu à la veille de la guerre l’ouvrage d’Alfred Rosmer contre l’Union sacrée avant Zimmerwald[7] et il me semblait qu’une réflexion sur l’internationalisme était opportune. Quant à la publicité de cette réunion, un communiqué fut envoyé à deux hebdomadaires : Action et Libertés (Hervé[8] et Rimbert[9]) qui le publièrent. J’apprendrai plus tard que notre initiative avait alerté le PS (SFIO) qui soupçonnait une manœuvre du PC pour amener des jeunes adhérents à rallier son adversaire. Un secrétaire local (de Saint-Cloud) fut chargé d’enquêter sur cet accord et me convoqua pour m’interroger. Ayant répondu en citant Karl Marx, il me rétorqua que Marx aurait eu des rapports avec les Hohenzollern !
C’est alors que je fus candidat pour des élections universitaires avec l’UJRF[10]. Bien entendu, nos réunions continuaient avec des sujets variés (je crois que je dissertai sur le « matérialisme historique »). Y participait aussi un groupe se réclamant de la revue Esprit d’Emmanuel Mounier ; on les appelait entre nous les Spiritos. C’étaient, dans l’ensemble, des catholiques plutôt proches du PC au début.
D’autres camarades, assez influencés par l’existentialisme, venaient. L’un d’eux se moquait gentiment de mon PS et je me défendais mollement, disant que j’attendais le retour de Marceau Pivert[11] (1919 S SC). Un ami d’avant-guerre était pivertiste.
Aux Étudiants socialistes (ES), dirigés à l’époque par Gérald Bloncourt[12], fils d’un député antillais, nous avions des réunions rue Lagrange dans le 5e arrondissement. J’écrivais des articles dans Jeunesse étudiante, l’organe de notre organisation (et je le transportais, le vendais, etc.). Parmi les adhérents, je rencontrais des camarades de la rue d’Ulm qui semblaient bien connaître les débats entre les leaders russes d’octobre 1917. Je fus un jour chargé de représenter les ES à une Assemblée des universitaires socialistes de la Sorbonne. Avec « mes gros sabots », j’y invoquai Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Le président répondit qu’il attendait la même ardeur pour la laïcité.
Par curiosité, je suivis un cours d’Armand Cuvillier (ENS L 1908), auteur d’un célèbre manuel de philosophie pour classes terminales des lycées qui m’avait alors intéressé surtout pour sa partie « sociologie ». Il était à l’Assemblée des universitaires socialistes.
Encore un évènement de cette époque : une réunion convoquée par des anticolonialistes en relation avec l’Indochine. Outre des Vietnamiens, il y avait des orateurs dont je découvrais les organisations : Néo-Destour, Istiqlal, UDMA, MTLD. Un jour arriva à l’École un groupe d’enseignants guadeloupéens venus y faire un stage. Un grand nombre, communistes, se réclamaient de leur députée, nommée Gerty Archimède[13]. Depuis mars 1946, ils avaient le statut départemental et je les mis en garde contre les illusions de cette mesure. J’ai gardé le souvenir de deux d’entre eux qui furent combatifs dans leur vie professionnelle. Je rencontrai l’un, professeur de philosophie à Paris dans un jury de baccalauréat. Il avait écrit un livre sur ses discussions à Saint-Cloud. Par la suite, je choisirai le plus souvent de me joindre au cortège des militants anticolonialistes dans les manifestations traditionnelles du mouvement ouvrier : hommage aux victimes de la semaine sanglante de la Commune en mai, Journée anniversaire des journées du 6 au 12 février 1934, le Premier mai, journée de lutte (surtout pas Fête du Travail !), parfois le 14 juillet.
A l’occasion d’une réunion en direction des intellectuels aux Sociétés savantes (nom d’une salle de la rue Serpente) avec Alexandre Bracke, Ernest Labrousse, René Lalou et Léon Boutbien, des parachutistes vinrent perturber le meeting en chantant « La Marseillaise ». Nous ripostons par « L’Internationale », ce qui nous fut reproché par des membres de la tribune. Il faut reconnaître que parmi ceux qui nous soutenaient se trouvaient des jeunes de la JCI (trotskystes).
Je voudrais maintenant relater un événement de notre vie de Cloutiers. A la fin de l’année scolaire, avait lieu un stage à la fois sportif, touristique et amical avec les Fontenaisiennes. En 1946, ce fut à Dinard. Je n’avais jamais vu la mer. Nous avions voyagé en bateau en longeant la côte, un émerveillement ! Mais je me souviens aussi d’une brouille à une soirée animée par des chants. Un inspecteur général de l’enseignement sportif nous reprocha de ne pas nous être opposés à l’interprétation, par une de nos camarades, d’une chanson « réaliste-érotique » ancienne, « L’Entraîneuse ». Ce n’était pas grave mais, nous dit-il, ce n’était pas sérieux et indigne de futurs enseignants. Il y a 75 ans de cela. L’année suivante, le stage eut lieu à Palavas-les-Flots dans d’autres circonstances mais il serait temps de relever d’autres aspects de nos activités culturelles dans ce début d’après-guerre.
Cinéma, théâtre, musique, littérature, peinture
Un évènement eut lieu dans le parc du château où nous allions régulièrement. Un rassemblement inattendu, le tournage d’un film ! Ce jour-là, le réalisateur Gérard Lampin, né en 1901 à Saint-Pétersbourg, tournait L’Idiot d’après Dostoïevski qui sortira à Paris en juin 1946. Les interprètes étaient Edwige Feuillère, Jean Debucourt, Marguerite Moreno et Gérard Philippe. Les deux derniers étaient alors filmés et je me souviens qu’oubliant les règles imposées, je fus réprimandé pour avoir parlé à voix haute pendant le tournage. Un certain nombre de Cloutiers présents furent pressentis comme figurants dans un film à venir du réalisateur, Retour à la vie. Effectivement ce film, dialogué par Charles Spaak, sortit en 1948. François Périer jouait dans un sketch. Le film évoquait les retours de prisonniers et déportés, et, dans une scène, des élèves de Saint-Cloud passaient comme figurants.
Les autres coréalisateurs étaient Cayatte, Jean Dreville et Clouzot. Nous étions quelques-uns à assister par la suite à des séances au cinéma de Saint-Cloud que fréquentait Clouzot venu défendre Le Corbeau tourné en 1943 mais alors interdit d’écran jusqu’à Quai des Orfèvres en 1947. J’assistai à plusieurs projections dans cette salle. Impressionné par cet aperçu du monde du cinéma, je me retrouvai souvent rue de Messine[14] à Paris où avaient lieu des projections de films inconnus des débuts du cinéma (stockés par Henri Langlois) cités par Georges Sadoul dans son Histoire du cinéma. C’est là que je découvre les œuvres des réalisateurs soviétiques d’avant les années 30. Bien que ce ne soit pas lié directement à l’histoire de la vie à Saint-Cloud, je ne peux m’empêcher d’indiquer brièvement certains aspects du cinéma en ce début d’après-guerre en ce qui concerne les institutions, organismes, cadres, etc. Par exemple la création du Centre national de la cinématographie (CNC), le festival de Cannes en septembre 1946, les histoires et chroniques de Georges Sadoul dans Les Lettres françaises, les revues spécialisées parfois présentes dans notre salle de réunion : La revue du cinéma (la première), La ligue de l’enseignement avec l’UFOLEIS[15], l’Association française des critiques de cinéma présidée par Georges Charensol.
Je me souviens que des Cloutiers étaient actifs dans PEC (Peuple et culture[16]) et TEC (Travail et culture). C’est eux qui ont invité André Bazin venu nous parler de Jean Gabin. Les ciné-clubs se développent, comme celui du cinéma local. Il faudrait se rappeler les films qui ont suscité des débats dans les années 45-47 : ceux de Louis Daquin, Robert Bresson, Jacques Becker, René Clément et toujours Jean Renoir, René Clair et bien d’autres que les cinéphiles retrouveront. N’oublions pas que 2000 films américains exercent une pression pour conquérir nos écrans. Et surtout, qu’en mai 1946, Léon Blum signe avec Byrnes[17] des accords défavorables au cinéma français ce qui provoque des manifestations du public et des professionnels : scénaristes, acteurs, réalisateurs, techniciens, etc. Des élèves de l’École y ont participé.
Au moment où, après le cinéma, j’allais disserter des pièces de théâtre qui avaient pu toucher les Cloutiers, je m’aperçois que j’en parle comme je le ferais aujourd’hui c’est-à-dire en m’entretenant du contenu des œuvres, de leurs auteurs. J’oublie que c’est d’un jeune de 23 ans, provincial plutôt inculte et aux ressources financières fort limitées dont j’ai à me souvenir. Or, pour ces spectacles, il faut indiquer que leur fréquentation dépendait de certains impératifs. Pour le cinéma, les tarifs dépendaient de la date de leur sortie. Il y avait les salles dites d’exclusivité, essentiellement dans les beaux quartiers, réservées au début de la carrière des films et les salles des autres quartiers où ils passaient ensuite. Je me souviens par exemple des Enfants du paradis (1945) qui resta près d’une année sur un écran des Champs-Élysées avant que je puisse y accéder car les prix d’entrée étaient très différents. Quant aux théâtres, il fallait s’efforcer d’atteindre le paradis (le poulailler) pour un prix d’entrée abordable. Les Cloutiers, à l’époque, bénéficiaient d’un pécule limité.
Comme le cinéma, le théâtre connut des années fécondes au lendemain de la guerre. Quand j’arrive à l’ENS de Saint-Cloud, on en est à la fin du débat « Faut-il brûler Kafka ? », question posée par l’hebdomadaire Action, alors qu’un peu plus tard Jean-Louis Barrault monte Le Procès. Jean Vilar commence à se faire connaître par ses mises en scène. Je me souviens de La Danse de mort de Strindberg et, en 1947, de la naissance du Festival d’Avignon. Je me rappelle être allé voir (mon premier spectacle) Antigone de Jean Anouilh. La pièce de Jean Genet, Les Bonnes, montée par Louis Jouvet fit scandale. Je me souviens d’avoir vu Le mal court de Jacques Audiberti dans une salle du Quartier latin. Armand Salacrou avait du succès mais c’est bien plus tard, après Saint-Cloud, que j’ai vu Boulevard Durand. Je ne suis pas tout à fait certain d’être allé voir Gérard Philippe dans Caligula ou La Peste d’Albert Camus. Par contre, je suis sûr de La maison de Bernarda de Federico Garcia Lorca mais un peu moins d’une soirée consacrée à Antonin Artaud (1946 ?) qui avait réuni André Breton, Alain Cuny et Roger Blin (proche politiquement). J’ai été attiré par une séance Prévert-Kosma au Théâtre Sarah Bernhardt mais pas par L’annonce faite à Marie de Paul Claudel. C’est plus tard que je suis passionné, ainsi que des camarades, par Bertolt Brecht (Maître Puntila). Et par Les mains sales après Huis clos de Sartre.
Au moment de mon départ de Saint-Cloud, je vais assister à la fameuse Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco et à une pièce d’Arthur Adamov. Je lisais la revue Théâtre populaire mais je dois préciser que ce n’est pas à l’École que j’ai discuté de ces séances que j’aurais sans doute oubliées sans des imprimés que j’ai pu conserver et qui ravivent mes souvenirs. Je suis cependant certain d’avoir assisté à l’ENS de Saint-Cloud à une séance où le mime Étienne Decroux était venu présenter ses créations. Il exigeait un silence absolu et interrompait sec son exercice au moindre bruit. D’autre part, j’ai suivi mes camarades à un concert, salle Gaveau, des Jeunesses musicales de France. Musique classique, sans doute. C’est bien plus tard que j’appris par exemple le nom d’un élève en 1945-1948 au Conservatoire, Pierre Boulez. Il faut reconnaître que je n’étais pas très attiré par cette musique. Par contre, je commençais à m’intéresser au jazz alors que j’avais quitté l’École.
C’est en 1947 que Marcel Duhamel créa la « Série noire » où on découvrait de nombreux auteurs de polars qui alimentaient les scénarios de films. La même année, la création du Reader’s Digest fut loin de nous intéresser.
Il faudrait maintenant se remémorer l’intérêt pour les Beaux-Arts d’autant plus que j’invitai un soir un critique dont j’ai oublié le nom, spécialisé dans la peinture moderne au moment où avait lieu le fameux débat du réalisme socialiste. Les épisodes ont été commentés dans des essais publiés après 1950 alors que j’avais quitté Saint-Cloud. Disons rapidement qu’il s’agissait de l’affaire André Fougeron du nom d’un peintre communiste présenté par le PCF comme un modèle après le Salon d’automne de 1948 où fut exposé « Parisiennes au marché » suivi par « Pays des mines » puis « Civilisation atlantique ». Le gouvernement fit même retirer certains tableaux qui furent remis. Le milieu des artistes adhérents ou sympathisants du PC participa au débat. Je citerai seulement Jean Amblard, Jean Milhau, Boris Taslitski, Édouard Pignon, Fernand Léger et Picasso[18]. Il faut dire qu’au lendemain de la guerre, l’Europe découvrit Kandinski, Atlan, Mondrian, Bazaine, de Staël, Vasarely, etc. Le problème était politique et c’est dans ce cadre que j’avais invité le critique mentionné plus haut. Je renvoie aux écrits des historiens pour la suite.
Je voudrais cependant parler d’une exposition dont je possède encore le catalogue de la galerie Maeght intitulé Le surréalisme en 1947 signé par André Breton revenu de Mexico et Marcel Duchamp qui avait signé la couverture (« Prière de toucher »). Dans les 24 textes illustrés de lithographies on trouvait, entre autres, Breton, Benjamin Péret, Brauner, Henri Miller, Julien Gracq, notre camarade Maurice Nadeau (31 L SC) (« Sade ou l’insurrection permanente »), Georges Bataille, Jean Arp, Aimé Césaire, les artistes Miro, Lam, Calder, etc. Une revue du groupe surréaliste, Rupture inaugurale, affirmait « l’attachement indéfectible à la tradition révolutionnaire du Mouvement ouvrier » (« dont le PCF s’écarte chaque jour », ajoutait-on). Sur le surréalisme d’après-guerre, on peut trouver beaucoup de choses dans un chapitre du livre de Maurice Nadeau.
En effet, alors que j’allais m’engager sur les influences que la littérature de l’époque avait pu avoir, j’ai retrouvé les mémoires de Nadeau publiés en 1990 chez Albin Michel, Grâces leur soient rendues. Pour connaître les épisodes de la vie intellectuelle et littéraire, cet ouvrage est très riche, en particulier pour notre période 1945-1950 où Nadeau est le critique du journal Combat. J’avais déjà relevé certains noms : en 1945, Kafka, Gracq, Bataille, Char, Romain Gary (Éducation européenne), Elsa Triolet (Le premier accroc coûte deux cents francs), Roger Vaillant (Drôle de jeu), Malraux (sortie du film L’Espoir). Camus, Prévert, Queneau, Arthur Koestler (Le Zéro et l’infini), Manès Sperber (Et le buisson devient cendre) au début de 1946.
Plus tard, des œuvres à caractère politique provoquèrent des discussions. Ainsi, Victor Kravchenko, ex-fonctionnaire soviétique (J’ai choisi la liberté), fut l’objet d’un procès avec Les Lettres françaises. En 1947, la parution de L’Ère des organisateurs de James Burnham (préfacé par Léon Blum) qui reprenait les thèses de Bruno Rizzi[19] fut l’objet d’âpres discussions y compris entre élèves. Je voudrais pour ma part retenir le nom de Pierre Naville. En arrivant à Paris, j’avais trouvé un petit livre, La crise française, qui annonçait la parution, aux éditions du Pavois, d’une revue qui se proposait d’aborder les problèmes économiques, scientifiques et sociaux. Ce fut La Revue internationale qui publia des études de Charles Bettelheim (un économiste spécialiste de la planification soviétique), de Pierre Bessaignet, de Gilles Martinet (journaliste puis leader du PSU), de Maurice Nadeau, de David Rousset, revenu des camps de concentration avec qui je fus en contact pour le faire venir à l’ENS de Saint-Cloud le 30 novembre 1946. Pierre Naville venait d’écrire sur l’avenir des élites et la réforme de l’enseignement[20]. Rousset publiera L’univers concentrationnaire puis Les jours de notre mort[21]. Pierre Naville se spécialisa dans les problèmes de la formation professionnelle. Je ne voudrais pas faire un catalogue de tous les auteurs qui m’ont interpellé à cette époque. Encore une fois, je renvoie au livre de Nadeau. Et j’en profite pour dire mon plaisir quand plus tard, je vis apparaître dans la liste des noms du comité de lecture de La Quinzaine littéraire celui de Louis Arenilla (45 L SC et 53 I SC)[22], mon camarade de promotion resté fidèle à Maurice Nadeau. Pour terminer avec les auteurs, je tiens à citer certains qui furent si actifs, en particulier dans le CNE (Comité national des écrivains) et les batailles du livre : Louis Aragon, Claude Roy, André Stil, Jean Laffitte, Pierre Daix.
Dans un autre domaine, je me bornerai à une allusion au débat « scientifique » sur l’affaire Lyssenko. J’ai gardé un souvenir triste d’un dialogue à Saint-Cloud entre un camarade « favorable à la ligne » et Marcel Prenant[23] qui, attaqué, refusait de condamner les positions de son parti sans pour autant capituler.
1947-1948 : La crise
Nous avons mentionné plusieurs aspects de la vie intellectuelle caractéristiques des premières années d’après-guerre. Certes, au-delà d’un certain unanimisme, nous pouvions déjà analyser différents courants de pensée mais les divergences étaient souvent surmontées. Je pense au problème de l’avenir de l’École, à ceux de l’adhésion à l’UGE ou à l’intersyndicale des ENS. Mais c’est au cours des années 1947-1948 que la quasi-unanimité se brisa car une crise profonde se développa à l’échelle du monde qui eut des répercussions dans notre milieu. Nous n’allons pas refaire, dans nos souvenirs, un cours d’histoire d’autant plus que nous avons déjà relevé dans notre tableau des années 1945-1946, que de nouveaux thèmes étaient apparus comme ceux de « rideau de fer », de « guerre froide », de rébellion des peuples colonisés, d’économies étranglées, de guerre civile (en Grèce). En France, les oppositions de classes sociales et entre mouvements politiques vont s’accentuer. Dès la fin de 1946, le tripartisme est en crise après le rejet par référendum du projet constitutionnel. Lors des élections à une nouvelle constituante, la SFIO et le MRP perdent des voix et des sièges alors que le PCF atteint presque 29% et redevient premier parti. A ce titre, Maurice Thorez se propose comme président du Conseil, députés communistes et socialistes ayant ensemble la majorité absolue. Mais le refus de voter pour lui de 25 députés SFIO le fait échouer. Vincent Auriol élu président de la République le 15 janvier choisit Ramadier comme Premier ministre. Le PC a cinq ministres dont Thorez.
En ce début de 1947, les problèmes de ravitaillement se posent d’autant plus que le niveau de vie des ouvriers a baissé et que les salaires sont bloqués alors que l’inflation augmente. Des économistes ont calculé que le niveau de vie moyen était inférieur de moitié à celui de 1939. Aussi des manifestations violentes ont lieu (Limoges, Amiens, Nevers, Lyon) dites « grèves de la faim ». D’autres grèves professionnelles que la CGT dénonce encore comme « fomentées par les trusts » durent parfois longtemps. En février-mars, il y a une grève de la presse puis une grève des postiers, une autre dans le métro. Parfois y participent des syndicats chrétiens (CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens) ou des syndiqués réformistes de la tendance Force ouvrière de la CGT, ou, à l’opposé, des syndicalistes révolutionnaires anarchisants. Le résultat d’élections aux Caisses de la Sécurité sociale montre une montée des voix CFTC inattendue. C’est à ce moment que je suis allé en Allemagne en février-mars dans une délégation des organisations de jeunesse. Bien que représentant de la Jeunesse socialiste, j’étais alors depuis plusieurs mois – clandestinement - dans le PCI (section de la 4e Internationale). La délégation présidée par le pasteur Jean Jousselin comprenait Jacques Denis pour l’UJRF (nous partagions souvent la même chambre). Nous étions invités par les autorités militaires de chacune des quatre zones d’occupation. Des articles sur ce voyage parurent alors dans Le Drapeau rouge, nouvel organe de la JS. Mais, au début avril, un congrès des JS vota des résolutions où était attaquée la politique du PS sur les salaires et la guerre d’Indochine. Notons que, depuis fin mars, avait lieu le soulèvement malgache et que le gouvernement (tripartite !) engagea une répression terrible contre les insurgés et le MDRM (Mouvement démocratique de la rénovation malgache) qui fit 90 000 morts[24]. D’autres difficultés avaient lieu au Maghreb.
Le vendredi 25 avril éclata une grève dans deux ateliers de l’usine Renault qui touchait 1 500 ouvriers. Étant alors attaché à une cellule PCI de l’usine, je connaissais l’action dans ce mouvement de l’Union communiste connue plus tard sous le nom de Lutte ouvrière. Comme l’usine de Billancourt était proche de l’ENS de Saint-Cloud (du métro Pont de Sèvres, on pouvait à pied accéder à l’École), j’organisai parmi les élèves une collecte pour les grévistes qui eut un certain succès. Il faut dire que les revendications salariales étaient justifiées mais la grève était, au début, attaquée car elle échappait à la direction syndicale ainsi qu’à celle du PCF. Le lundi 28, le nombre des grévistes était passé à 10 000 et le mardi 29 à 20 000. Des responsables syndicaux, inquiets, venaient au siège du PC et la CGT se ralliait à la grève en s’adressant à la direction de l’usine tout en invitant, par un vote, à la reprise (qui fut repoussée à 80%). Le 30 avril, le soutien était officiel. Mais le PS au pouvoir était contre. Le lendemain, le cortège du Premier mai dura six heures avec des slogans (« Prime à la production, minimum vital, le charbon de la Ruhr ! »). J’y distribuais un tract du comité de grève ce qui me fit expulser par le service d’ordre ! A la tribune dressée place de la Concorde, se trouvaient, pour saluer la fin de la manifestation Eugène Henaff, Benoît Frachon (CGT), Maurice Thorez (PCF), Daniel Mayer (SFIO, ministre du travail, qui fut sifflé). Le 4 mai députés et ministres communistes s’étant opposés à la politique de blocage des salaires, Ramadier révoqua les ministres du PC. Le 16 mai, le travail reprenait chez Renault. Lors d’une manifestation au Mur des Fédérés au Père-Lachaise, j’avais conspué Ramadier au cri de « Démission ! ». La direction du PS décida ensuite la dissolution de la direction élue des JS. La majorité refusa de céder. Je fus convoqué à la commission des conflits et exclu le 8 juin de la SFIO. Je fus satisfait, n’ayant plus à cacher mon appartenance politique réelle !
J’ai peut-être trop développé ce conflit Renault car il marquait le début d’une nouvelle période dans les luttes sociales. Mais c’étaient les vacances scolaires et le stage habituel des normaliens se déroulait à Palavas-les-Flots près de Montpellier. C’était mon premier séjour dans le sud de la France. La Méditerranée, les excursions en Provence, au Languedoc, les Pyrénées orientales : que de découvertes ! Sans exclure les discussions. Je n’étais même pas intéressé par le congrès du PS où certains espéraient que la dissolution n’était pas définitive. Au même moment, au congrès de Strasbourg, le PC rejetait le plan Marshall mais c’est encore le retour au gouvernement qui est revendiqué. En juillet et août, trois accords entre CGT et CNPF sont signés sur une hausse prévisible des salaires refusée par le pouvoir d’où une grève dans l’automobile.
Le 22 septembre, alors que L’Humanité reproduit des propos de Thorez (Le PC est et restera un parti de gouvernement), le même jour, s’ouvre en Pologne la conférence de Szklarska Poręba où neuf partis communistes sont représentés. Celui d’URSS par Jdanov et Malenkov, le PCF par Duclos et Fajon. En dehors du PC italien, les autres sont ceux des pays de l’Est. Dans son rapport inaugural, Jdanov décrit la nouvelle situation : le combat est celui des deux camps. Le camp impérialiste dirigé par les États-Unis qui veulent l’hégémonie mondiale et le camp anti-impérialiste de la paix qui veut renforcer la démocratie et les indépendances nationales. Le surlendemain, le représentant yougoslave Edvard Kardelj critique durement la politique des partis français et italien (Duclos fait sa première autocritique le lendemain). Enfin la conférence approuve la création d’un bureau d’information de ces partis : le Kominform. Le 2 octobre, Thorez dénonce dans un meeting « le parti américain » et fait le 20 l’autocritique du comité central du Parti. Le 16, Léon Blum parle d’une troisième force contre le PC et le RPF.
En novembre un mouvement de grève va s’étendre dans toute la France. Je me contente d’en indiquer les épisodes. A Marseille du 10 au 12 novembre, une grève générale suite à une hausse tarifaire des tramways est suivie d’une émeute contre la Mairie qui est passée au RPF. Le maire est chassé, les administrations occupées. On a beaucoup parlé de l’attitude des CRS : voir la mise au point par notre camarade René Gallissot[25] (55 L SC) dans la revue Le mouvement social. Un manifestant, Vincent Voullant, est tué. Le 15 novembre dans les Houillères du Nord où Léon Delfosse, administrateur et secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol (FNTSS-CGT), est révoqué, la grève éclate. Les mineurs se battent contre les CRS et l’armée envoyée par le ministre Jules Moch. Les violences ont lieu entre grévistes et « forces de l’ordre », entre « jaunes » et « rouges », entre communistes et socialistes. Il y a des morts. Le 9 décembre un train dérailla (21 victimes). Les grèves s’étendent à la sidérurgie, le textile, la chimie, etc. Le 29 novembre, vingt fédérations constituent un comité central de grève pour diriger la lutte. Le gouvernement organise la riposte contre ce qu’il appelle une « une grève insurrectionnelle » : rappel de réservistes (la classe 43 dont je suis avec quelques camarades cloutiers), vote de mesures de « défense républicaine » à l’Assemblée nationale où le député Raoul Calas occupe la tribune toute la nuit et chante « Gloire au 17e », allusion au refus du 17e régiment de tirer sur le peuple, à Béziers, en 1907. Sur le terrain, des ouvriers CFTC - groupes FO demandent des votes secrets. Des incidents violents ont lieu à Nice, Béziers. Une grève à l’EDF échoua. Le ministre du travail Daniel Mayer demande de cesser le mouvement ce qui eut lieu le 9 décembre avec la dissolution du comité central de grève. Comme il est souvent indiqué que le mouvement se poursuit chez les enseignants, il nous faut étudier à part cette grève.
La grève des enseignants fut parallèle à celle de la CGT qui luttait pour le minimum vital et contre le plan Marshall. Celle de la FGE (Fédération générale des enseignants) portait sur le reclassement de la Fonction publique dans le cadre de l’UGFF (Union générale des fédérations de fonctionnaires). Par ailleurs, la direction de la FGE était assez hétérogène. Le SNI en était la pièce maîtresse et son secrétaire, Henri Aigueperse, avait été adhérent de la Fédération unitaire des enseignants (FUE) dès 1921, à l’époque de la CGTU, avant de revenir au SNI en 1934. En 1947, les unitaires communistes étaient Paul Delanoue et Georges Cogniot et leur tendance était pour répondre au comité central de grève. L’UGFF avait déjà lancé plusieurs fois des mots d’ordre de grève pour le reclassement que le gouvernement repoussait - et l’UGFF annulait (exemples : 15 novembre et 20 novembre). La section parisienne du SNI, combative, décida la grève. Au cours de ces discussions j’étais souvent à la Bourse du travail avec des amis syndiqués de la tendance École émancipée. Prudent, Aigueperse soutint la décision de la Seine mais sans engager toute son organisation car Ramadier venait de démissionner. La FEN (ou FGE), seule, fait la grève du 5 au 9 décembre, les autres fédérations refusant d’y participer. La grève fut suivie massivement dans l’unité. A l’ENS de Saint-Cloud, nous fîmes grève et un comité se mit en place. C’est en tant que délégué de ce comité que j’accompagnai une délégation de la CGT (de Boulogne-Billancourt ?) dans une entreprise du voisinage (les Pompes Guinard) pour les inciter à entrer dans le mouvement. Je me souviens d’un militant du groupe, persuadé que « c’était parti » ainsi que l’expliquait Lénine dans Que faire ? qu’il venait de relire la veille. A l’École nous étions bien déterminés. Même que l’un d’entre nous, humoriste souvent, nous faisait chanter sur un air de cantique catho :
Ah Joseph Djougachvili / Le plus grand de tous les prophètes…
Mais restons sérieux car ces grèves se terminaient en définitive par un quasi-échec et provoquaient une double coupure. La CGT scissionnait, le groupe FO décidant le départ le 19 décembre pour former une nouvelle confédération. L’UGFF éclatait car aucune des fédérations de fonctionnaires n’avait suivi la FEN. Celle-ci allait décider, par vote de tous ses membres de passer à l’autonomie. J’étais délégué avec Henri Bordas (46 L SC), un camarade de l’École de la section SNES, au congrès syndical de la région parisienne où je défendis le maintien d’une CGT unique et démocratique.
Malgré ces ruptures, le mouvement socialiste continuera en 1948 avec une série de grèves chez les mineurs en avril et octobre, les métallos, des fonctionnaires, un ordre de grève générale dans la région parisienne. Comme en 1947, le gouvernement Queuille dénonce une « grève insurrectionnelle », rappelle des réservistes, l’armée dégage les mines. La guerre d’Indochine continue. Après le nouveau statut de l’Algérie voté en 1947, les colons français opposés au gouverneur Yves Chataigneau jugé trop « libéral » obtiennent son remplacement. C’est Marcel-Edmond Naegelen (1913 S SC), député socialiste, ministre de l’Éducation, un Alsacien opposé à toutes les tendances autonomistes, qui fut nommé gouverneur général à la veille des élections de l’Assemblée algérienne. Il fut alors responsable d’une fraude électorale massive. Une douzaine de candidats du MTLD[26] sont emprisonnés, les communes sont quadrillées par l’armée (par exemple à Bône, le MTLD qui avait obtenu 6 500 voix au premier tour en « comptabilise » 96 au second). A l’Assemblée, les nationalistes obtiennent onze sièges (et le RPF de De Gaulle 42). La possibilité d’action légale disparaît. On aurait préféré que cet ancien Cloutier reste ministre de l’Éducation nationale et honore de sa présence les bals de l’École ! Il redevint député en juin 1951.
Le plus important de 1948 fut pour nous la condamnation de Tito par le Kominform le 28 juin, approuvée par le comité central du PCF le 8 juillet. Certes la guerre froide s’était accentuée avec le blocus de Berlin, le « coup de Prague », le Pacte atlantique[27]. On craignait une guerre réelle. Exemples de déclaration : « Le peuple français ne fera jamais la guerre à l’Union soviétique », « La paix ne tient qu’à un fil ». Un congrès mondial pour la paix d’intellectuels a lieu à Wrocław (Pologne). En URSS au même moment, la Pravda publiait un texte annonçant l’offensive de Lyssenko à l’Académie d’agronomie qui débouchera sur la théorie des « deux sciences ». D’autre part, au ministère russe des affaires étrangères, Molotov était remplacé par Andreï Vychinski connu comme le procureur des procès de Moscou d’avant-guerre. L’année suivante eurent lieu les procès du Hongrois László Rajk et du Bulgare Traïcho Kostov. Je me souviens d’avoir fait un exposé sur ces deux séries de procès à l’ENS de Saint-Cloud en 1949. J’étais très engagé à l’époque dans la campagne pour l’envoi de brigades en Yougoslavie[28].
Mais revenons à un autre évènement de 1948. Le 8 janvier je devenais le père de mon fils Gérard, né à Vincennes. Je voudrais ajouter quelques mots aux allocutions rendant hommage à Henri Canac parues dans le Bulletin de l’Amicale lors du Centenaire de l’École. J’avais lu à cette époque avec plaisir et émotion les textes d’anciens élèves : Paul Rivenc (45 L SC), Maurice Fauquet (45 L SC), Raymond Lallez (44 L SC) et Roger Viovy (46 S SC). Ce dernier affirmait que Henri Canac (21 L SC), gardien des traditions, était heureux de voir que certains élèves étaient « sortis de la norme » et qu’il encourageait les déviations les plus importantes. Bien entendu, toute sa vie démontrait que ces « déviations » n’étaient pas de celles condamnables sans appel mais il visait ceux qui pouvaient avoir fait une carrière non-traditionnelle… Je me reproche encore d’avoir essayé de lui mentir en lui annonçant la naissance de mon fils. Il se disait surpris parce que je ne lui avais pas fait part de mon mariage. Je tentai de le convaincre que si, je l’avais fait. Il n’insista pas mais il était clair qu’il n’était pas convaincu car il nous connaissait si bien ! A cette époque, je croyais que l’opinion générale était qu’il n’était pas « convenable » de se marier seulement deux mois avant la naissance de son enfant. En tout cas, je suis moins présent à Saint-Cloud dans les deux dernières années tout en gardant des relations régulières avec mes camarades. Ainsi, l’un d’eux, Henri Bordas, vint m’annoncer la parution prochaine d’une nouvelle revue, La Nouvelle critique. Mais je m’aperçois que jusqu’à présent, je n’ai pas exposé ni commenté mes études supérieures alors que le fait d’être à Saint-Cloud en était la raison. Serait-ce une « déviation » ?
Mes études à l’ENS de Saint-Cloud
A Saint-Cloud, en tant que littéraire, je suis les cours de Raymond Bayer[29] (1919 L SC) et d’Henri Gouhier (ENS L 1919). En même temps, je me rends à la Sorbonne où je prépare le certificat de psychologie avec option psychopathologie à l’Hôpital Sainte-Anne où un professeur nous présente un malade qu’il interroge. Je suis passionné par ces séances où je découvre une science inconnue. Au Trocadéro (Musée de l’Homme), je suivis aussi des cours d’anthropologie de Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan et j’étais bien tenté d’entendre les discussions de l’ONU, le Palais de Chaillot étant devenu Palais de l’ONU de septembre à décembre 1948.
A la Sorbonne, je rencontre un « groupe marxiste » avec Pierre Kast[30] et François Châtelet[31] qui me semblent proche du parti communiste. Je sympathise avec Châtelet que je retrouverai plus tard dans le Comité des intellectuels contre la guerre en Afrique du Nord, et, encore plus tard dans le mouvement 68. Les jeunes communistes se réunissent dans un local du boulevard Saint-Michel à l’angle du boulevard Saint-Germain.
A l’occasion d’élections universitaires j’y rencontrerai un dirigeant populaire parmi eux, Roger Garaudy, dont l’évolution les aurait bien surpris. Pour l’état de la philosophie de cette époque, je dois avouer qu’après soixante-quinze années, j’aurais des difficultés à me souvenir même en m’aidant d’une étude de François Wahl (« Panorama de la philosophie française de l’existentialisme à Teilhard de Chardin ») qui porte sur une quinzaine d’années de l’après-guerre[32]. Il y trouvait une « exigence de rigueur ». Il rapportait à ce sujet certaines remarques de Simone de Beauvoir dans Mémoires d’une jeune fille rangée sur l’enseignement de Léon Brunschvicg (ENS L 1888) dans les années 30 : « un enseignement tout à fait abstrait […] qui ne tenait aucun compte de la vie et même de l’être des choses » auquel s’opposait la philosophie bergsonienne qui garantissait « un accord de l’homme avec la nature en deçà même de la pensée ». Contre ce « double confort », Wahl distinguait trois courants de pensée présents, en gros, dans notre vie universitaire. L’existentialisme avec la dualité sartrienne de l’être et du néant, de l’en-soi et du pour-soi. Comme je l’ai déjà indiqué au début de ce texte, ce contact de Cloutier, ce n’est pas le lieu d’en faire un exposé dont je serais d’ailleurs incapable de me souvenir. Wahl y décèle un pessimisme alors que deux philosophies optimistes le flanquaient : le marxisme et une pensée « chrétienne renouvelée ». Quelques mots seulement pour les caractériser. Le premier, dans cette période stalinienne, serait plus vivant dans l’activité critique des « modalités de la pensée bourgeoise » que l’on trouve chez Jean-Toussaint Desanti (ENS L 1935) et Tran Duc Thao (ENS L 1939) en histoire de la philosophie, chez Henri Lefebvre en esthétique et dans la Critique des fondements de la psychologie de Georges Politzer. Quant à la pensée chrétienne, elle a retrouvé une force dans l’action contre l’occupant (et peut-être contre l’Église officielle). Wahl cite Gabriel Marcel, Maurice Blondel (ENS L 1881), Emmanuel Mounier et le personnalisme, et enfin Paul Ricœur. Cet inventaire est sans doute restreint mais je me garderai bien de me plonger aujourd’hui dans ces philosophies. D’autant plus que l’on peut y ajouter Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Jean Piaget, Martial Gueroult (ENS L 1912). Pour plus de concret, quelques remarques : l’essentiel des œuvres philosophiques sont éditées par les Presses universitaires de France (ou Vrin, Aubier). Aux PUF, les collections de la bibliothèque de philosophie contemporaine comprennent alors quatre séries : « Logique et philosophie des sciences » dirigée par Gaston Bachelard ; « Morale et valeurs » par René Le Senne ; « Histoire de la philosophie » par Émile Bréhier ; « Psychologie et sociologie » par Maurice Pradines. Les quatre directeurs sont professeurs à la Sorbonne.
Parmi les maîtres qui m’ont marqué, je citerai Jules Vuillemin (ENS L 1939) dont j’ai mentionné la présence au lycée de Besançon en 1943. Je l’ai retrouvé en Sorbonne dans un cours sur Hegel et puis à l’ENS de Saint-Cloud comme assistant. Il avait déjà publié dans une revue de philosophie et un ouvrage aux PUF, Essai sur la signification de la mort. Je me souviens avoir fait avec lui un exposé sur « le concept ». Il préparait sa thèse, L’Être et le travail, sur les conditions dialectiques de la psychologie et de la sociologie qui paraîtra en 1949. Il avait été influencé par l’existentialisme, surtout par Merleau-Ponty : avec les circonstances de la guerre, « l’engagement nous semblait comme le pain et le vin. » Il publia alors dans Les Temps modernes des articles (Gandhi, Nietzsche, une traduction de Marx, sur le travail forcé, sur l’esthétique, etc.). Dans les années 50, il fut nommé à Clermont-Ferrand et étudia les mathématiques de Descartes puis l’histoire de la philosophie à la lumière de Gueroult qui l’influença beaucoup. Dès 1962, il occupa la chaire de philosophie au Collège de France succédant à Merleau-Ponty (ENS L 1924) et présenté par Martial Gueroult.
Mais revenons à Saint-Cloud. A l’École, on nous présenta Max Hugueny (ENS L 1928) qui nous expliqua clairement la nécessité d’apprendre le latin et le grec, langues mortes indispensables pour obtenir licence, agrégation et plus. Comme la presque totalité des Cloutiers avait été élèves-maîtres dans les Écoles normales d’instituteurs, on ne peut dire que cette obligation nous enchantait. Non par opposition aux langues mortes mais à l’investissement intellectuel et de temps si important quand il y avait tant d’intérêts dans l’environnement. Je me demande parfois si je me trompais en délaissant progressivement cet enseignement. Pourtant je m’y suis (un peu) plié puisque dans le certificat d’histoire de la philosophie et dans celui d’études littéraires classiques il y avait en plus de la partie de la discipline habituelle (philosophie et littérature) une version latine. J’avais calculé qu’en obtenant une note supérieure à la moyenne aux premières, je pouvais compenser le déficit de la version. Disons que ça a marché ! Mais en ce qui concerne le CAEC de philosophie, j’assume ma non-préparation et mon échec. Étant licencié, je pus préparer mon DES.
A partir de mes études et de mes activités militantes, j’étais intéressé à la fois par la philosophie et la politique. En philosophie, j’avais travaillé sur Hegel à la fois par la Sorbonne et par des études de revues et diverses publications. Les travaux de Jean Hyppolite (ENS L 1924) sur la phénoménologie et surtout sur la conception de l’État et la parution de l’Introduction à la lecture de Hegel d’Alexandre Kojève. Quant aux textes politiques sur la théorie de l’État chez Marx, il y avait abondance. Bref mon diplôme s’intitulait La théorie de l’État chez Hegel et sa critique par la gauche hégélienne. Raymond Bayer (1919 L SC) accepta de le diriger, de m’interroger et de me noter largement. On m’indiqua que ce diplôme pouvait être qualifié diplôme d’histoire. Je me décidai à me présenter au professorat d’histoire d’autant que, dans mes discussions avec mes camarades communistes, j’étais effaré par leur méconnaissance de l’histoire de leur organisation et du mouvement ouvrier dans l’entre-deux-guerres. Deux professeurs à Saint-Cloud m’intéressaient : Édouard Perroy[33] qui comblait mon ignorance totale du Moyen Âge et Émile Tersen[34] sur les relations internationales. Dans cette période, j’avais appris la création aux Archives nationales de l’Institut français d’histoire sociale par Jean Maitron[35]. Patronné par Émile Tersen, j’y adhérai.
Après l’ENS de Saint-Cloud
Comme je continuais mon militantisme, il fallut que, adjoint d’enseignement à l’École normale d’instituteurs de Commercy, j’attende deux ans pour réussir mon CAPES d’histoire-géographie. A l’École normale de Commercy, l’inspecteur d’académie de la Meuse vint me trouver en novembre 1952 pour me proposer d’être détaché dans un « Collège d’Europe » à Bruges dont j’ignorais l’existence. Il s’agissait d’une institution récente, dirigée par un universitaire et écrivain néerlandais, Henri (Hendrik) Brugmans, qui voulait rassembler des étudiants de différentes nationalités pour les former et les employer dans les futurs organismes européens. A ce moment, la CECA commençait à se mettre en place. J’ai cru comprendre que le directeur-adjoint de l’ENS de Saint-Cloud, Henri Canac (21 L SC)[36], avait été sollicité pour donner son avis. Ayant eu l’occasion d’accepter mon départ en Allemagne occupée avec différents mouvements de jeunesse en 1947, il avait sans doute indiqué mon nom. J’appris ultérieurement que ce fut un autre Cloutier, le germaniste Aimé Carpentier (45 L SC), qui me succéda. Un des enseignants du Collège était Maurice Le Lannou (ENS L 1928), géographe, qui dirigea un voyage en Sardaigne. A Bruges, je présentai alors un exposé sur les luttes sociales pendant la Révolution française. Notons encore un voyage par avion à Berlin peu de temps avant le soulèvement de juin 1953. Opposé à l’orientation vers une Europe capitaliste, je refusai de collaborer à la revue Les Cahiers de Bruges. En mai 2020, c’est avec amusement que j’ai découvert un article du Monde (« L’accession problématique de Federica Mogherini à la tête du Collège d’Europe, à Bruges », 15 mai 2020).
A la sortie de l’École, une autre histoire commença pour moi qu’on retrouvera dans le Dictionnaire Maitron[37].
René LEMARQUIS (45 L SC),
Montreuil, décembre 2020
[1] La rafle du Vel’ d’Hiv’ à Paris et dans son agglomération, le « Jeudi noir » comme l’appellent les Juifs, l’opération « Vent printanier » selon le code allemand, visant les familles juives étrangères eut lieu les 16 et 17 juillet 1942. Il y eut 13 000 arrestations dont 4 000 enfants. Le jeune frère de l’amie de ma femme qui avait alors 14 ans a publié sous le nom de Maurice Rajsfus, Jeudi noir, L'honneur perdu de la France profonde, L’Harmattan, 1998, 216 p. et d’autres ouvrages, dont Drancy. Un camp de concentration très ordinaire, 1941-1944, Le Cherche-Midi, 2004, 490 p. (Note de l’auteur)
[2] https://maitron.fr/spip.php?article9801. Notice de Michel Dreyfus. Sauf mention spéciale, les notes ont été ajoutées par les éditrices.
[3] André Paris : https://alumni.ens-lyon.fr/page/r ;
Jean Madre : https://alumni.ens-lyon.fr/page/souvenirs-d-un-historien-entre-a-saint-cloud-en-19 ;
Henri Denise : https://alumni.ens-lyon.fr/page/entrer-a-saint-cloud-en-1944
[4] Voir https://www.iker.cnrs.fr/jean-haritschelhar-zendu-da.html. Sur la création en 2016 de la chaire Haritschelhar : https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/international/annee-2016-2017/naissance-de-la-chaire-jean-haritschelhar-en-faveur-des-relations-transfrontalieres.html
[5] Rassemblement national populaire, ancien parti collaborationniste (1941-1944) fondé par M. Déat.
[6] AMGOT est l’acronyme de Allied Military Government of the Occupated Territories, plan défini dès 1941-1942 par les États-Unis, et qui visait à imposer un protectorat, une pax americana dans les pays occupés par l’Axe (Rome-Berlin-Tokyo), y compris en Italie, en Allemagne et au Japon. De Gaulle réussit à l’éviter en installant le GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) reconnu par Roosevelt le 23 octobre 1944.
[7] Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre Mondiale, tome I, De l'Union sacrée à Zimmerwald, Librairie du Travail, 1936. Réédition Éditions d'Avron, 1993. Réédition Les Bons Caractères, 2018. Ouvrage suivi d’un second volume : Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre Mondiale, tome II, De Zimmerwald à la Révolution Russe, Mouton & Co, 1959. Réédition Éditions d'Avron, 1993. Réédition Les Bons Caractères, 2018.
[8] Pierre Hervé, membre du comité directeur d’Action (https://maitron.fr/spip.php?article75831).
[9] Charles Torielli, dit Pierre Rimbert (1909-1991), « militant au syndicat CGTU du livre, exclu du PCF en 1932, s’était rapproché des trotskistes puis entra à la SFIO, en 1934. Pendant l’Occupation, il anime le groupe et la revue Libertés. » Source Marcel Cachin, Carnets, t. IV, CNRS Éditions, 1997.
https://books.openedition.org/editionscnrs/35242?lang=fr#ftn173
[10] Union de la jeunesse républicaine de France (1945-1956).
[11] Marceau Pivert, parti aux États-Unis en 1940, trouve un asile politique au Mexique et revient en France en avril 1946.
[13] Première femme inscrite au barreau de la Guadeloupe (1939), cette avocate interrompit ses activités lorsqu’elle fut députée (10 nov. 1946 - 17 avril 1951, groupe PCF).
[14] Fondée en 1936, la Cinémathèque dispose à compter du 26 octobre 1948 d’une salle de projection de 60 places au 7 rue de Messine (75008 Paris) ; à cette même adresse est inauguré le premier musée du cinéma d'Henri Langlois.
[15] L’UFOLEIS est la fédération de Ciné-Clubs de la Ligue Française de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente.
[16] Peuple et Culture est un mouvement agréé d’éducation populaire (http://www.peuple-et-culture.org/).
[18] Voir l’ouvrage Libres comme l’art, L’Atelier, 2020 et l’exposition prévue en 2021 au siège du PC dans le cadre du centenaire du Parti, annoncée par la vidéo http://www.le-chiffon-rouge-morlaix.fr/2020/11/centenaire-du-pcf-picasso-leger-miailhe-fougeron-et-les-autres-le-pcf-et-les-artistes-au-lendemain-de-la-guerre.html
[19] Exilé à Paris, B. Rizzi y publie à compte d’auteur La Bureaucratisation du monde en 1939 sous le nom Bruno R. Ce livre est interdit par l’occupant nazi dès 1940.
[20] « La réforme de l’enseignement dans l’impasse », La revue internationale, n° 9, octobre 1946.
[21] Respectivement 1946 et 1947. Maurice Nadeau est alors éditeur aux éditions du Pavois.
[22] https://www.whoswho.fr/decede/biographie-louis-arenilla_6977 et fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Arenilla
[24] Sur ce chiffre, voir le bas de la page https://www.herodote.net/29_mars_1947-evenement-19470329.php
[25] Sur sa carrière et ses archives conservées à La Contemporaine, voir l’importante notice : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2195 ou https://francearchives.fr/findingaid/ea878da3f31b979fbea6f30ef6bc83ae67430bcd.
Son œuvre : https://www.idref.fr/026879905. Et un entretien (2016) :
http://revueperiode.net/generation-algerienne-entretien-avec-rene-gallissot/#identifier_7_3443
[26] Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques.
[27] OTAN, organisation issue du traité dit de l’Alliance atlantique Nord (4 avril 1949) entre douze états. La France s’est retirée en 1966 de l’organisation militaire mais reste membre de l’Alliance.
[28] Voir cette activité au §6 de la page : https://maitron.fr/spip.php?article140277 (Note de l’auteur)
[29] Raymond Bayer (1898-1959) était professeur de philosophie à la Sorbonne. Fondateur avec Charles Lalo et Étienne Souriau de la Revue d'esthétique, il s’occupait aussi d’histoire des sciences et conçut le plan du « Corpus des philosophes français » visant à publier « tous les philosophes mineurs, par lesquels s’exprime la tradition française » (Bibliographie de la philosophie, VI (1948) 2).
[32] Revue Tendances, n°6, mars 1960, 32 p. (Note de l’auteur)
[33] Médiéviste, spécialiste de l'histoire de l'Angleterre des XIVe et XVe siècles, É. Perroy enseignait aussi à Fontenay et à Sèvres.
[34] https://maitron.fr/spip.php?article176270
[35] https://maitron.fr/spip.php?article23901 et https://www.dailymotion.com/video/xwubfy
[36] Secrétaire général puis directeur adjoint de l’ENS de Saint-Cloud de 1937 à 1970.
[37] Notice https://maitron.fr/spip.php?article140277
Ce témoignage a été initialement publié dans le Bulletin de l’Association des élèves et anciens élèves des ENS de Lyon, Fontenay, Saint-Cloud, 2021, n°1 .